Содержание
- Introduction — pourquoi parler des crises et des convulsions ?
- Définitions claires : crise, convulsion, épilepsie — quelle différence ?
- Pourquoi les crises surviennent-elles ? Causes et facteurs déclenchants
- Comment reconnaître une crise ou une convulsion ? Signes et symptômes
- Diagnostic : quelles investigations après une crise ?
- Traitements : comment se soigner et prévenir les récidives ?
- Que faire en cas de crise : guide étape par étape pour les témoins
- Cas particuliers : enfants, femmes enceintes, personnes âgées
- Vivre avec des crises : qualité de vie, travail, conduite
- Tableau récapitulatif : types de crises, symptômes et réponses
- Mythes et idées reçues — ce qu’il faut corriger
- Prévention, suivi et prise en charge à long terme
- Recherche et perspectives — vers de meilleures prises en charge
- Ressources utiles
- À retenir — conseils pratiques en bref
- La place de l’entourage
- Points sensibles et limites de l’information
- Conclusion
Introduction — pourquoi parler des crises et des convulsions ?
Les maladies neurologiques touchent des millions de personnes dans le monde et, parmi elles, celles qui provoquent des crises et des convulsions suscitent souvent peur et incompréhension. Peut-être avez-vous déjà assisté à une crise, connu quelqu’un qui en fait l’expérience, ou ressentez-vous l’angoisse que provoque l’idée d’une perte de contrôle du corps. Dans cet article, je vous propose d’explorer, étape par étape et de manière accessible, ce que sont précisément les crises et les convulsions, comment les reconnaître, quelles en sont les causes fréquentes, comment réagir sur le moment, quelles sont les options de traitement et comment vivre au quotidien avec ces troubles. Mon objectif est de démystifier ces phénomènes, d’offrir des repères concrets et de vous encourager à consulter un professionnel pour toute question médicale précise.
Définitions claires : crise, convulsion, épilepsie — quelle différence ?
L’un des premiers obstacles à la compréhension est la confusion entre plusieurs termes. Une « crise » est un terme large qui désigne un épisode soudain lié à une activité électrique anormale du cerveau. Une « convulsion » est une manifestation clinique possible d’une crise : contractions musculaires involontaires, parfois généralisées. L’épilepsie, elle, est un diagnostic qui suppose une prédisposition durable à avoir des crises récurrentes non provoquées. On peut donc avoir une convulsion sans épilepsie (par exemple après une intoxication ou une forte fièvre) et, inversement, avoir des crises focales sans convulsions visibles.
Quelques précisions utiles
Les crises peuvent être classées selon leur origine et leur expression :
- Crises focales : elles proviennent d’une partie limitée du cerveau. Les symptômes peuvent être discrets (fourmillements, déja-vu, trouble du langage) ou évoluer vers une généralisation.
- Crises généralisées : elles impliquent dès le début les deux hémisphères du cerveau et peuvent se traduire par une perte de conscience et des convulsions bilatérales.
- Crises dites non épileptiques : elles ressemblent parfois à des crises d’épilepsie mais ont une origine psychologique ou fonctionnelle.
Pourquoi les crises surviennent-elles ? Causes et facteurs déclenchants
Les causes des crises sont multiples et s’entremêlent souvent. Certaines sont liées à une lésion ou une maladie du cerveau, d’autres à des perturbations métaboliques, toxiques ou à des facteurs externes. Voici les grands groupes de causes que l’on rencontre le plus fréquemment.
Causes neurologiques et structurelles
Les lésions cérébrales aiguës ou chroniques (traumatisme crânien, tumeur cérébrale, malformation vasculaire, séquelle d’AVC) peuvent déclencher des crises. Les infections du système nerveux central (méningite, encéphalite) et certaines maladies dégénératives favorisent aussi l’apparition d’épisodes convulsifs.
Causes métaboliques et toxiques
Des déséquilibres comme l’hypoglycémie (taux de sucre trop bas), l’hyponatrémie (sodium bas), des insuffisances hépatiques ou rénales, ou l’intoxication par l’alcool, des drogues ou certains médicaments peuvent provoquer des convulsions. Parfois, la sevrage alcoolique est un moment à haut risque.
Causes génétiques et idiopathiques
Certaines formes d’épilepsie ont une forte composante génétique, surtout lorsqu’elles apparaissent chez l’enfant. Dans beaucoup de cas, aucune cause définie n’est retrouvée ; on parle alors d’épilepsie idiopathique.
Facteurs déclenchants
Outre la cause sous-jacente, de nombreux facteurs peuvent déclencher une crise chez une personne prédisposée : manque de sommeil, stress, consommation d’alcool, lumière stroboscopique (écrans, discothèques), certaines infections, fièvre chez l’enfant, variations hormonales chez la femme, non-observance du traitement antiépileptique.
Comment reconnaître une crise ou une convulsion ? Signes et symptômes
La présentation clinique est très variable. Il est utile d’apprendre à repérer certains signes pour mieux agir au moment opportun.
Signes fréquents d’une crise
- Perte soudaine de conscience ou altération de la vigilance.
- Mouvements involontaires : secousses rythmiques (myocloniques), raideur généralisée (tétanie), mâchonnements ou mouvements automatiques (automatismes) pour les crises focales.
- Sensations anormales : paresthésies, hallucinations sensorielles, aura olfactive ou gustative.
- Confusion, amnésie de l’événement après le réveil.
- Changements de la respiration : respiration bruyante ou arrêt respiratoire temporaire.
Signes alarmants — quand appeler les secours
Il faut considérer comme urgence et appeler les services d’urgence si :
- la crise dure plus de 5 minutes (statut épileptique suspecté) ;
- les crises se répètent sans reprise de conscience entre elles ;
- la personne a du diabète et la crise pourrait être liée à une hypoglycémie ;
- la personne est enceinte, blessée, ou a des difficultés respiratoires sévères ;
- la crise survient pour la première fois chez un adulte.
Diagnostic : quelles investigations après une crise ?
Poser un diagnostic repose sur l’histoire clinique (récit des témoins), l’examen neurologique et des examens complémentaires adaptés.
Interrogatoire et examen
Le médecin cherchera la description de la crise (durée, mouvements, perte de conscience), les antécédents, les facteurs déclenchants et l’état neurologique entre les crises. Les témoignages vidéo sont souvent précieux.
Examens complémentaires
- Électroencéphalogramme (EEG) : enregistre l’activité électrique cérébrale. Un EEG standard peut manquer certaines anomalies ; des enregistrements prolongés ou vidéo-EEG sont parfois nécessaires.
- Imagerie cérébrale (IRM de préférence) : pour rechercher une lésion structurale (tumeur, cicatrice, malformation).
- Bilan biologique : glycémie, ionogramme, fonctions rénales et hépatiques, bilan infectieux si suspecté.
- Tests spécialisés : études génétiques, ponction lombaire si infection suspectée.
Traitements : comment se soigner et prévenir les récidives ?
Le traitement dépend du type de crise, de la cause identifiée et de l’impact sur la vie de la personne. On distingue les traitements aigus (pour arrêter une crise) des traitements chroniques (pour prévenir les crises).
Traitement des crises aigües
Dans l’urgence, les benzodiazépines (diazépam, lorazépam) sont souvent utilisées pour arrêter une crise prolongée. En milieu hospitalier, d’autres traitements peuvent être administrés si la crise ne cède pas.
Traitement de fond
Les médicaments antiépileptiques (MAE) sont prescrits pour réduire la fréquence des crises. Le choix du médicament tient compte :
- du type de crise et du syndrome épileptique ;
- des effets secondaires potentiels ;
- des interactions médicamenteuses ;
- des projets de grossesse (certains MAE sont tératogènes) ;
- des préférences du patient et de la tolérance.
Pour certaines personnes résistantes aux médicaments, des options comme la chirurgie d’épilepsie (ablation d’une zone épileptogène), la stimulation nerveuse vagale ou la stimulation cérébrale profonde peuvent être proposées.
Approche non médicamenteuse et modes de vie
Modifier certains comportements peut réduire le risque de crises : régulariser le sommeil, éviter l’alcool en excès, gérer le stress, respecter l’observance du traitement, et identifier les déclencheurs individuels. Les techniques de relaxation, la psychothérapie (notamment en cas de crises non épileptiques d’origine psychologique) et un accompagnement social sont souvent utiles.
Que faire en cas de crise : guide étape par étape pour les témoins
Savoir comment agir peut sauver des vies et éviter des blessures. Voici une démarche simple, pratique et sécurisante à suivre.
Étapes immédiates
- Restez calme et protégez la personne : écartez les objets dangereux autour d’elle pour éviter les blessures.
- Notez l’heure de début de la crise : cela aide le service médical à décider des gestes à réaliser.
- Ne tentez pas de retenir les mouvements ni d’ouvrir la bouche de force ; ne mettez rien dans la bouche.
- Placez la personne sur le côté (position latérale de sécurité) dès que possible pour faciliter la respiration et prévenir l’étouffement en cas de vomissements.
- Défaites les vêtements serrés au niveau du cou pour faciliter la respiration.
- Appelez les secours si la crise dure plus de 5 minutes, si une autre crise survient immédiatement après, si la personne ne reprend pas conscience, ou si vous suspectez une blessure grave.
Ce qu’il ne faut pas faire
- Ne pas essayer d’administrer un médicament par la bouche pendant la crise.
- Ne pas frapper ni provoquer la douleur pour « réveiller » la personne.
- Ne pas employer de manœuvres risquées qui pourraient blesser la personne.
Cas particuliers : enfants, femmes enceintes, personnes âgées
Les contextes particuliers méritent une attention adaptée. Chez l’enfant, la fièvre peut déclencher des convulsions fébriles : elles sont souvent bénignes mais doivent être évaluées par un professionnel. Chez la femme enceinte, l’équilibre entre risque de crise et effets des médicaments sur le fœtus est délicat ; il nécessite un suivi spécialisé. Chez la personne âgée, des causes métaboliques, vasculaires ou médicamenteuses sont souvent à rechercher en priorité.
Vivre avec des crises : qualité de vie, travail, conduite

Un diagnostic d’épilepsie ou de troubles convulsifs bouleverse parfois le quotidien. Il est important de savoir qu’avec un bon suivi, beaucoup de personnes mènent une vie active et épanouie.
Travail et études
Selon la fréquence des crises, des aménagements peuvent être nécessaires (horaires, tâches à risque évitées). Les employeurs peuvent proposer des adaptations raisonnables ; les services sociaux et associations peuvent aider à faire valoir les droits.
Permis de conduire
Les règles varient selon les pays et dépendent de la durée sans crise attestée par un médecin. Informez-vous auprès des autorités locales et suivez les recommandations médicales pour la sécurité routière.
Activités à risque
Il est conseillé d’adapter certaines activités (baignade sans surveillance, escalade) si les crises ne sont pas contrôlées. Les sports peuvent être pratiqués avec des mesures de sécurité adaptées.
Tableau récapitulatif : types de crises, symptômes et réponses
| Type de crise | Symptômes typiques | Réponse immédiate |
|---|---|---|
| Crise généralisée tonico-clonique | Perte de conscience, raideur puis secousses rythmiques | Protéger, position latérale, appeler secours si >5 min |
| Crise focale avec altération de la conscience | Automatismes, regard fixé, confusion | Rassurer, éviter les gestes brusques, surveiller la durée |
| Absence | Brève interruption de la conscience, regard fixe, retour rapide | Noter la durée, consulter si répétition fréquente |
| Crise myoclonique | Secousses brèves, souvent groupées | Surveiller, rechercher étiologie |
| Crise non épileptique psychogène | Apparence similaire à une convulsion mais contexte psychologique | Assurer sécurité, éviter confrontation, orientation psychologique |
Mythes et idées reçues — ce qu’il faut corriger
Il existe beaucoup de croyances erronées autour des crises. En voici quelques-unes à rectifier :
- Mythe : la personne avale sa langue pendant une crise. Réalité : impossible ; il ne faut pas mettre les doigts dans la bouche.
- Mythe : toutes les crises sont des crises d’épilepsie. Réalité : certaines crises sont provoquées et réversibles, d’autres non épileptiques sont psychologiques.
- Mythe : on ne peut rien faire pour une personne qui a des crises fréquentes. Réalité : il existe de nombreux traitements et stratégies pour réduire les crises et améliorer la qualité de vie.
Prévention, suivi et prise en charge à long terme
La prévention passe par l’identification et la correction des facteurs déclenchants (traiter une infection, corriger un déséquilibre métabolique, éviter le sevrage alcoolique brutal). Le suivi régulier avec un neurologue ou un centre d’épilepsie permet d’ajuster les traitements, d’évaluer les effets secondaires et d’envisager des options chirurgicales si nécessaire. Les groupes de soutien et associations apportent un soutien précieux pour l’information, l’orientation et l’accompagnement social.
Recherche et perspectives — vers de meilleures prises en charge
La recherche avance sur de multiples fronts : nouveaux antiépileptiques, techniques de neuro-imagerie plus fines, stimulation neuro-modulatrice, thérapies géniques pour certaines épilepsies génétiques, et compréhension des mécanismes cellulaires des crises. Ces progrès promettent une prise en charge plus personnalisée et efficace à l’avenir.
Ressources utiles
Il existe des associations, des centres spécialisés et des ressources en ligne fiables qui peuvent aider les patients et leurs proches : centres hospitaliers universitaires, associations nationales d’épilepsie, organismes de santé publique. N’hésitez pas à demander à votre médecin traitant des contacts adaptés à votre région.
À retenir — conseils pratiques en bref

- Apprenez à reconnaître les différents types de crises et notez la durée lorsque vous en assistez une.
- Protégez la personne et mettez-la en position latérale de sécurité ; n’essayez pas de mettre quelque chose dans sa bouche.
- Appelez les secours si la crise dure plus de 5 minutes, si les crises se répètent sans récupération, ou si la personne est blessée ou enceinte.
- Consultez un neurologue après une première crise ou en cas de récidive : un bilan est nécessaire pour poser un diagnostic et proposer un traitement.
- Respectez les traitements prescrits et signalez tout effet indésirable ; pensez aux aménagements de vie (sommeil, alcool, gestion du stress).
La place de l’entourage
Le rôle des proches est crucial : observation, soutien, aide pour l’organisation des rendez-vous médicaux et soutien émotionnel. Adopter une attitude informée et non stigmatisante facilite la vie de la personne concernée. Des formations aux gestes de premiers secours et des groupes de parole peuvent renforcer la compétence et la confiance de l’entourage.
Points sensibles et limites de l’information
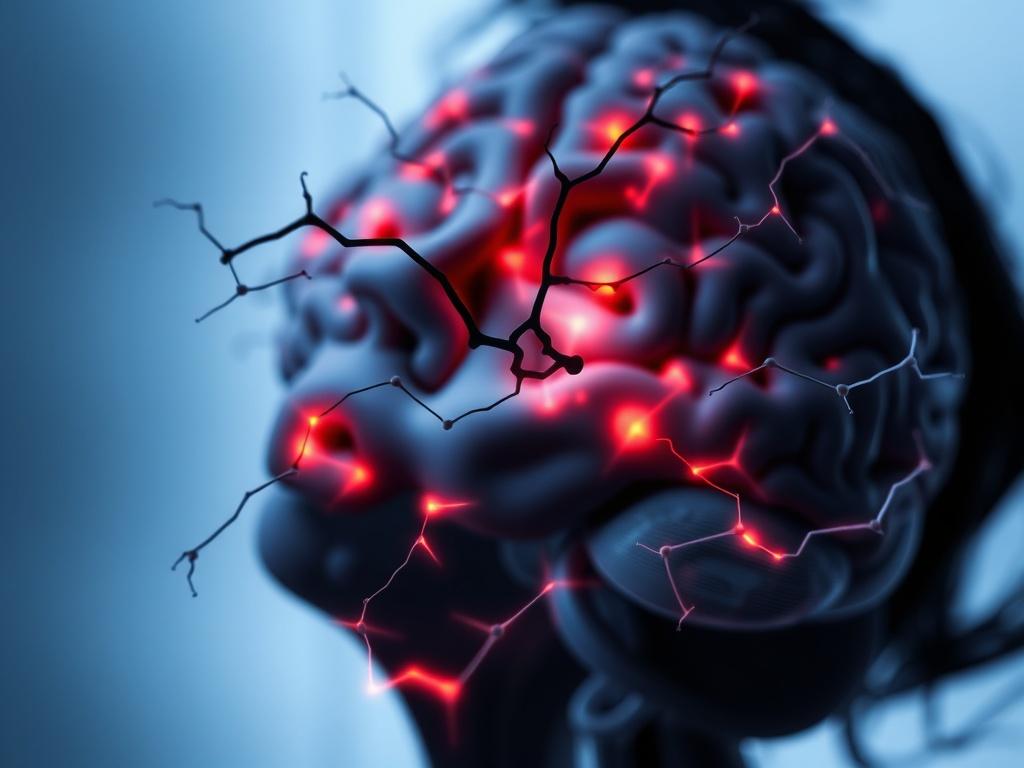
Cet article vise à informer de manière générale et n’a pas vocation à remplacer un avis médical personnalisé. Les informations médicales évoluent et certains cas demandent des évaluations approfondies. En présence d’un événement grave ou inhabituel, il est essentiel de consulter rapidement un service de santé.
Conclusion
Les crises et les convulsions sont des manifestations impressionnantes de dysfonctionnements neurologiques, mais elles sont aussi des symptômes dont l’identification, la prise en charge et la prévention sont possibles. Comprendre les différences entre crise, convulsion et épilepsie, savoir reconnaître les signes, connaître les gestes d’urgence et consulter pour un bilan adapté sont des étapes essentielles pour réduire les risques et améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Les traitements médicaux, les interventions chirurgicales lorsque nécessaires, et les mesures de vie quotidienne permettent souvent un bon contrôle des crises. L’espoir repose aussi sur la recherche continue qui apporte régulièrement de nouvelles options thérapeutiques. Si vous ou un proche êtes concernés, n’attendez pas pour chercher de l’aide : un bon diagnostic, un suivi spécialisé et un entourage informé font souvent la différence entre peur et maîtrise.





